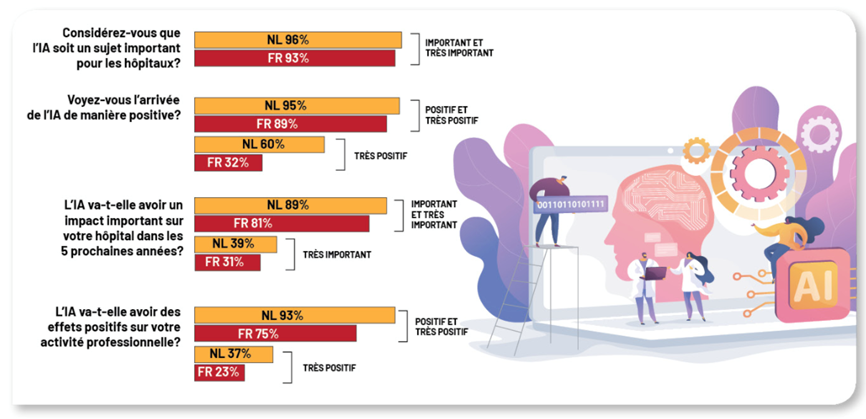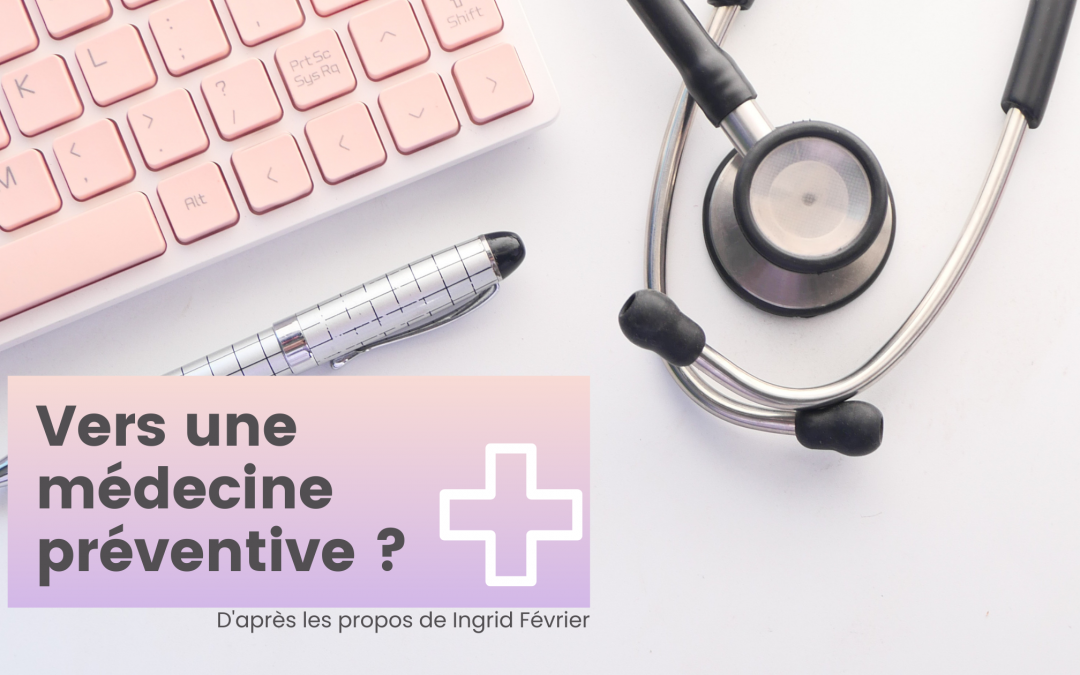Prendre soin du personnel soignant grâce au compas de la sérénité
Le bien-être est un sujet de société auquel nous ne pouvons plus échapper. Qu’il s’agisse « d’être bien » dans sa vie privée ou dans son environnement de travail, nombreux sont les articles, les conseils, les coachs, les formations et autres ateliers qui nous invitent à repenser le bien-être sous toutes ses formes. Et depuis quelques années, la question du bien-être se propage de plus en plus en entreprise. En 2022, le SPF Emploi lançait d’ailleurs son « plan d’action national pour améliorer le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail »[1]. Le SPF Emploi relie cette notion de bien-être au travail à « l’ensemble des facteurs relatifs aux conditions de travail dans lesquelles le travail est exécuté. » Des facteurs comme la sécurité au travail, la protection de la santé du travailleur ou encore les aspects psychosociaux du travail. Cependant, lorsque nous pensons « bien-être en organisation », il nous arrive rarement d’envisager celui du personnel qui chaque jour se dévoue dans nos hôpitaux au service de notre santé. Pourtant, le personnel soignant fait partie des publics les plus touchés par cette crise du bien-être. En effet, au-delà de leurs enjeux et contextes propres, qu’ils soient publics ou privés, tous les hôpitaux belges partagent un même dénominateur commun : le mal-être et le désengagement d’une partie de leur personnel soignant.
La crise invisible : l’épuisement des soignants en chiffres
En 2020 – 2021, lors de la crise de la COVID, les études et articles en tous genres ont mis en exergue l’épuisement du personnel soignant belge, soulignant que 40 à 60% de celui-ci était épuisé et risquait l’erreur.[2] Un constat alarmant, qui a pourtant démarré bien avant la crise sanitaire. En effet, cela fait maintenant plus de 10 ans que le phénomène de quantification[3] des hôpitaux est enclenché, détournant l’hôpital de son idéologie humaniste au profit de donnée quantifiables, mesurables et budgétisables. Un phénomène connu qui n’est pas sans conséquence pour nos soignants, qui se retrouvent aujourd’hui confrontés à un énorme mal-être ainsi qu’un manque de sens croissant dans leur métier. Une situation amplifiée par la pénurie de personnel qui se fait ressentir au sein de l’ensemble des hôpitaux belges.
Si originellement, le métier de soignant est un métier de passion et de vocation, il se mue peu à peu en un métier parfois maltraitant et contraignant, constamment mis sous la pression du résultat et du « toujours plus, avec moins ». Il y a un renversement du pouvoir qui, des mains des médecins et soignants, pour œuvrer à sauver la vie, a échoué dans les mains des gestionnaires dans un but de rationalisation ultime et de décisions parfois bien désincarnées de la réalité de terrain, puisque nourrie par cette poursuite du Graal de la quantification, parfois même au détriment d’une certaine qualité.
De fait, infirmiers, aides-soignants et autres métiers de soin ont pour vocation intrinsèque de « prendre soin ». Ce « prendre soin » permet au personnel soignant de se connecter réellement au côté humain de leur métier, considérant les patients comme des êtres humains, qui ont des besoins, des ressentis et des contextes spécifiques. Or, aujourd’hui, il est de plus en plus demandé à nos soignants de « soigner » de manière quantifiée et quantifiable, en laissant le « prendre soin » de côté au détriment du résultat. Une quantification qui déshumanise toujours plus nos hôpitaux, au grand dam aussi bien de ses patients que de ses travailleurs.
Les gestionnaires hospitaliers s’étonnent même de certains phénomènes, à la suite de l’améliorations des processus ou à l’implémentation d’outils de gestion, figures de proue de cette campagne de quantification.
Parfois, ils doivent constater que, même si du temps se libère ou est potentiellement disponible pour ce “prendre soin “, le goût, la motivation ou même l’envie n’y est plus.
C’est comme si l’approche de quantification, de performance et d’efficacité avait détourné, pollué ou détruit le sens et la motivation de se mettre au service de la vie et du soin à l’autre.
Les gestionnaires hospitaliers font face à un dilemme complexe : répondre aux exigences de performance imposées par les politiques de santé tout en préservant la qualité des soins et le bien-être du personnel. Conscients des limites de la quantification excessive, ils reconnaissent l’importance de rétablir un équilibre entre les impératifs quantitatifs et la dimension humaine des soins.
Il arrive toutefois que certaines initiatives reconnectent les soignants et les médecins au sens et à la motivation, l’éco responsabilité dans le secteur hospitalier en est le meilleur exemple. Il est beaucoup plus simple de retrouver du sens et de la motivation pour adapter certaines pratiques pour des raisons d’écologie et de durabilité, plutôt que pour des raisons d’économie. Et ces initiatives ont souvent pour effet secondaire une réduction substantielle des coûts de fonctionnement laissant à penser que la quantification et l’humanisation ne sont pas nécessairement antagonistes mais peuvent œuvrer main dans la main, dans un cercle vertueux.
Il semble donc fondamental de creuser avant tout la piste de la restauration de la motivation et du sentiment d’œuvrer pour quelque chose d’utile et de plus grand.
« Il y a un énorme mal-être du personnel soignant. Or sa simple existence est fondamentale par rapport à la société de manière générale. Et une société qui ne prend pas à bras le corps cette problématique de mal-être du personnel soignant… C’est quand même particulier. » Ce n’est plus à prouver : plus que jamais, notre société a besoin de ces professionnels dont la vocation est de « prendre soin ».
Mais qui prend soin de nos soignants ?

Un outil pour transformer le mal-être en bien-être
Chez Convidencia, nous ne prétendons pas, à nous seuls, être en mesure de résoudre cette situation hautement complexe et multifactorielle. Cependant, nous proposons, à notre échelle, la mise en place d’un « trajet de soin » pour le personnel soignant, basé sur l’un de nos outils : le COMPAS de la Sérénité.
Le COMPAS de la Sérénité est un modèle intégratif développé par Lionel Barets, CEO de Convidencia, afin d’équiper tout un chacun face à deux grands phénomènes prégnants dans notre société : le stress ambiant et le manque croissant de joie. Dans un environnement malmenant et qui fluctue constamment – comme c’est le cas dans nos hôpitaux – le COMPAS vise à adresser, à hauteur de chaque individu, comment conserver le plus de sérénité possible afin de pouvoir traverser les difficultés, se reconnecter à un état serein et rayonner une énergie plus positive et constructive, autant pour soi que pour les autres. Pour ce faire, il invite à être attentif et à nourrir 5 grands piliers : la Compréhension, le Contrôle, le Plaisir, l’Apaisement et le Sens.
L’idée principale de ce modèle très pragmatique est que nous n’avons pas de contrôle sur les autres, ni sur les situations auxquelles nous sommes confrontés ; cependant, nous avons du contrôle sur nous-mêmes. Lionel, fondateur de Convidencia et auteur du COMPAS, explique : « Le COMPAS aide les individus et les équipes à trouver une forme d’équilibre dans des situations très changeantes, et à reprendre le contrôle sur leur santé mentale dans un monde complexe, incertain et maltraitant. Le modèle n’explique pas tout, mais permet de voir plus clair sur les raisons de notre état et ce sur quoi nous devrions focaliser notre énergie. »
« Le COMPAS aide les individus et les équipes à trouver une forme d’équilibre dans des situations très changeantes, et à reprendre le contrôle sur leur santé mentale dans un monde complexe, incertain et maltraitant. Le modèle n’explique pas tout, mais permet de voir plus clair sur les raisons de notre état et ce sur quoi nous devrions focaliser notre énergie. »
Par le biais de cet outil redoutablement simple et efficace, l’idée est de permettre au personnel soignant de reprendre du contrôle sur une situation qui les dépasse depuis longtemps, de regagner en motivation et de se reconnecter au sens de leur métier, de retrouver le « pourquoi » qui les anime et les a poussés à emprunter cette voie.

Car dans un contexte de plus en plus difficile et incertain, c’est en nous que nous pouvons trouver la résilience et la motivation nécessaires afin de traverser une situation difficile et cultiver notre sentiment de joie. Ingrid ajoute : « Je pense que le COMPAS a ce merveilleux potentiel de reconnecter les êtres humains avec leur humanité. » Or, dans un secteur aussi déshumanisé que celui de l’hôpital, Convidencia a le souhait, à son échelle, d’aider nos soignants à se reconnecter à leur humanité. Notamment en évaluant, individuellement, si chacun possède les niveaux de compréhension, de contrôle, de plaisir, d’apaisement et de sens suffisants que pour pouvoir réfléchir et mettre en place des choses qui pourront les apaiser et les (re)connecter à de la sérénité.
Reprenez le contrôle grâce à des actions concrètes pour cultiver la joie au travail
En conclusion, face à l’épuisement et à la déshumanisation croissante de nos hôpitaux, il est impératif de redonner du sens et de la sérénité au personnel soignant. Leur bien-être n’est pas seulement une question de productivité, mais de dignité humaine. Le COMPAS de la Sérénité, développé par Lionel Barets, offre une approche pragmatique et intégrative pour aider chaque soignant à retrouver le contrôle sur sa santé mentale, à se reconnecter à ses motivations profondes et à restaurer son équilibre émotionnel.
À travers ce modèle, nous ne prétendons pas résoudre tous les problèmes, mais nous croyons fermement en sa capacité à initier un changement positif. En nourrissant les piliers de la Compréhension, du Contrôle, du Plaisir, de l’Apaisement et du Sens, nous offrons à chaque soignant une boussole pour naviguer dans les eaux tumultueuses de leur quotidien professionnel.
Rappelons-nous que prendre soin de ceux qui prennent soin de nous est une responsabilité collective. En redonnant du pouvoir et de l’humanité à nos soignants, nous créons non seulement un environnement de travail plus sain, mais nous renforçons également les fondations mêmes de notre système de santé. Ensemble, cultivons la résilience et la joie pour bâtir des hôpitaux où chaque soignant peut s’épanouir et où chaque patient reçoit les soins humains et attentifs qu’il mérite.
Parce que derrière chaque uniforme se cache un être humain, et il est grand temps de prendre soin d’eux avec la même dévotion et la même passion qu’ils nous accordent chaque jour. Le COMPAS de la Sérénité n’est pas seulement un outil, mais une invitation à redécouvrir l’essence même du soin – une essence faite d’humanité, de compassion et de respect mutuel.
Rencontrez nos experts, les visionnaires derrière le COMPAS de la Sérénité
Afin d’aider chaque individu à se reconnecter à sa motivation et à sa joie dans des contextes particulièrement compliqués, Lionel Barets a publié en avril 2023 son e-book gratuit « Cultiver sa joie dans un contexte ingrat avec des petits PAS ». Convidencia réalise également des trajets sur-mesure visant à accompagner les équipes, les dirigeants et les managers à reprendre le contrôle sur des situations complexes en cultivant leur résilience et leur joie. Si ce type de trajet vous intéresse et/ou que vous souhaitez discuter de votre situation, n’hésitez pas à nous contacter info@convidencia.com.
En savoir plus sur les auteurs
Lionel BARETS – ingénieur de formation puis consultant en gestion de projet et de crise, Lionel a fondé la société Convidencia en 2008 pour accompagner les entreprises dans leur évolution culturelle et organisationnelle. Expert en diagnostic organisationnel et dynamique participative, Lionel accompagne, avec son équipe, les dirigeants et leur organisation dans leur transformation. Lionel est également chroniqueur sur LN24 et dans des magazines spécialisés et auteur de plusieurs livres de management. Son premier livre : « ParticipAgile, comment développer la participation et l’agilité dans votre organisation » est sorti en 2019 et son livre « La cohérence en entreprise : relevez le défi avec la Salutogénèse Appliquée » en 2021, quelques années avant la parution de son e-book gratuit « Cultiver sa joie dans un contexte ingrat avec des petits PAS » en 2023, introduisant le modèle du COMPAS de la Sérénité.
Ingrid FEVRIER – Juriste de formation, Ingrid a travaillé pendant 17 ans aux Mutualités Chrétiennes avant de devenir Directrice stratégie & développement de la Clinique Saint-Pierre d’Ottignies. Elle s’est par la suite dirigée vers le People Management et la gestion du changement pour favoriser l’amélioration continue, l’efficacité et le bien-être au travail. En tant que Partner et Senior Change Architect chez Convidencia, elle accompagne les entreprises dans leur développement en intégrant, notamment l’agilité, l’innovation et la définition de leur stratégie.
[1] https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail#:~:text=Le%20bien%2D%C3%AAtre%20au%20travail,aspects%20psychosociaux%20du%20travail
[2] https://lpost.be/2021/05/21/soignants-et-burn-out-entre-40-et-60-du-personnel-sont-epuises-et-risquent-lerreur/
[3] Les méthodes quantitatives sont des méthodes de recherche, utilisant des outils d’analyse mathématiques et statistiques, en vue de décrire, d’expliquer et prédire des phénomènes par le biais de données historiques sous forme de variables mesurables. (Source, Wikipedia)